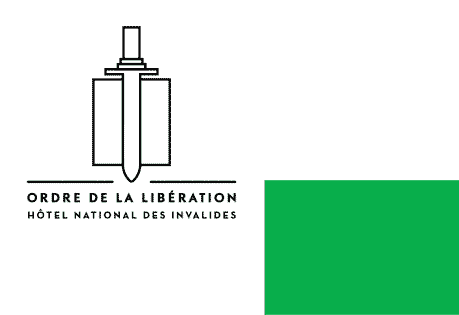Stéphane FUCHS
Biographie
Né le 1er octobre 1906 à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), Stéphane Fuchs est issu d’une famille aisée d’origine alsacienne et protestante. Stéphane choisit, comme son père, d’épouser la carrière médicale et sa formation intellectuelle doit beaucoup au pasteur Boegner, ainsi qu’à son frère André, pasteur à Strasbourg. Marié et père d’un enfant, externe aux hôpitaux de Paris de 1928 à 1932, il exerce durant cette période successivement dans plusieurs hôpitaux : Saint-Antoine (1928), La Rochefoucauld (1929), Charité puis Enfants malades (1930), Laennec (1931), Saint-Louis (1931 et 1932). Il soutient sa thèse et obtient son diplôme de docteur en médecine le 7 juillet 1932. Il est également diplômé en biologie.
Mobilisé comme médecin lieutenant le 12 septembre 1939 à l’ambulance médicale d’armée 93 à Marseille, il rejoint le 6e régiment de tirailleurs marocains le 11 janvier 1940. Stéphane Fuchs est démobilisé le 5 septembre 1940 à Bourg.
Fin 1940, Stéphane Fuchs rejoint le réseau Marine comme agent de renseignement. Il travaille en étroite collaboration avec l'officier polonais Tadeusez Jekiel. Il semblerait que Fuchs ait également eu des contacts à Paris, Lyon et Vichy avec diverses organisations de résistance telles que Liberté, Vérité ou Les Petites Ailes. Afin de couvrir ses activités clandestines, il installe chez son ami, le docteur Marion-Gallois, 26 boulevard d'Athènes à Marseille, le siège d'une revue fictive, "La France médicale". Stéphane Fuchs devient l'un des responsables du secteur Marseille - Port-Vendres du réseau Marine avec Toussaint Raffini. En février 1941, le réseau Marine est rattaché au réseau franco-polonais F2 et prend le nom de PO4 Marine. Ses activités clandestines le conduisent alors à Nice et Marseille où il est arrêté le 22 décembre 1941.
Jugé par la section spéciale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il est condamné à trois ans de prison le 10 mars 1942. Il arrive à Eysses le 15 octobre 1943 après avoir été incarcéré à Aix, au fort Monluc à Lyon puis à Nîmes. A Eysses, une organisation se met en place au sein des détenus. Le directeur de la prison accepte de rencontrer régulièrement les deux délégués désignés par les détenus politiques : Stéphane Fuchs et Henri Auzias. Ceux-ci lui présentent les doléances des détenus. Auzias et Fuchs s'imposent alors comme les leaders du collectif d'Eysses. Après la tentative d'évasion collective du 19 février 1944, Stéphane Fuchs est retenu comme otage au quartier cellulaire de la centrale. De tendance gaulliste, il théorise l'esprit de résistance qui l'anime dans un texte qu’il écrit alors qu’il est détenu au quartier cellulaire d’Eysses, intitulé "perdons-nous notre temps en prison ?".
Le 30 mai 1944, il est livré aux Allemands avec ses co-détenus puis déporté le 2 juillet 1944 de Compiègne à Dachau dans le convoi dit « train de la mort ». Au moment du départ pour l'Allemagne, les anciens d'Eysses parviennent à rester groupés (une trentaine dans un wagon, une vingtaine dans un autre). Ils organisent la répartition des vivres et de l'eau, se préoccupent de l'hygiène, grâce notamment à l'autorité des deux médecins du groupe, Paul Weil et Stéphane Fuchs. Les deux hommes réussissent à imposer la discipline entre les déportés. La solidarité entre les Eyssois a sans nul doute joué et elle explique, en partie, une relative sous-mortalité à l'intérieur de ce groupe. Arrivé à Dachau le 5 juillet 1944, Stéphane Fuchs est transféré à Natzweiler le 22 juillet 1944 puis dans les camps du Neckar où il restera jusqu’en mai 1945.
Il a été homologué chargé de mission de 3e classe avec le grade de sous-lieutenant au titre du réseau F2. A son retour de déportation, Stéphane Fuchs devient le premier président de l’amicale des anciens d’Eysses. Il est décoré de la médaille de la Résistance française le 24 avril 1946. Spécialisé dans la médecine du Travail et l’hygiène industrielle, il devient expert et chargé de mission au Bureau international du Travail à Genève. Décédé le 4 octobre 1970 à Paris, il fut incinéré au crématorium du cimetière du Père-Lachaise.